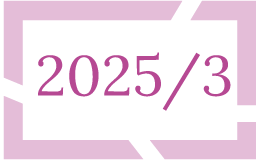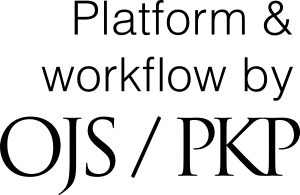Femmes, genre et (re)définition des obligations juridiques – passées et présentes
Résumé
Depuis la réélection de Donald Trump comme président des Etats-Unis et le début de son second mandat en janvier 2025, il devient difficile de tenir la chronique de toutes les mesures qui, dans un grand nombre de domaines, remettent en cause des droits élémentaires, des institutions fondamentales, des procédures essentielles. Certes, les décrets (executive orders) que le nouveau président multiplie tous azimuts sont soumis au contrôle des cours et tribunaux, et effectivement jugés illégaux en nombre. Pour autant, on ne saurait oublier la position de la Cour suprême qui prend appui sur son interprétation (éminemment présidentialiste) de la séparation des pouvoirs pour valider à ce titre des mesures – ce qui lui permet d’éviter de se prononcer au fond, y compris face à certaines remises en cause brutales du fonctionnement de l’État américain. Il ne faudrait pas non plus négliger les effets de sidération et de glaciation (chilling effect) que provoque cette nouvelle pratique du pouvoir.
D’emblée, les questions de genre ont été au cœur des préoccupations de la nouvelle administration présidentielle. Dès le 20 janvier, l’Executive Order Defending Women From Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government donnait le ton, lui qui, entre autres choses, impose une définition du sexe comme renvoyant « à la classification biologique immuable de l’individu » - il serait donc soit masculin soit féminin - et précise que « “sexe” n’est pas un synonyme et n’inclut pas le concept d’ “identité de genre” ». Aussitôt après, comme on le sait, de nombreux termes (parmi lesquels « genre » et tous ses usages, mais aussi « femmes », « trans » ou « sexe ») ont été ciblés comme indices des politiques de diversité réputées illégales, car discriminatoires, par l’Executive Order du 21 janvier 2025 enjoignant à tous les ministères et agences fédéraux d’y mettre fin.
Sans négliger ou ignorer que les États-Unis ne sont pas le seul pays dans lequel l’égalité de genre - dans toutes les acceptions possibles de l'expression - est menacée, Intersections. Revue semestrielle Genre & Droit ne souhaite pas demeurer indifférente ou silencieuse face à ces (r)évolutions.
Nous espérons pouvoir proposer, dans le prochain numéro, des analyses de fond sur plusieurs aspects de ce tir de barrage contre la prétendue « idéologie du genre » ou sur la manière dont d’autres aspects de la politique menée par la nouvelle présidence affecte l’égalité de genre. Mais, sans attendre, nous sommes très honoré·e·s de publier un article de la professeure de droit à la Yale Law School, Judith Resnik - une éminente spécialiste du système judiciaire, carcéral et administratif états-unien. Elle y propose un retour sur les luttes qui, depuis les années 1960, avaient précisément permis aux professions juridiques de s’ouvrir à la diversité et de réfléchir aux conditions d’une justice égale pour tous·tes. Ce rappel de l’importance de l’action collective face à l’adversité résonne puissamment aujourd’hui.
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
(c) Tous droits réservés Intersections. Revue semestrielle Genre & Droit 2025

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.