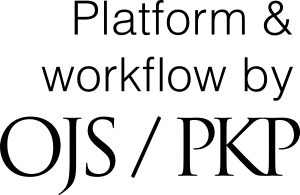Appel à contributions pour le n°6 La colonialité du genre : perspectives juridiques
Le projet Intersections. Revue semestrielle Genre & Droit s’inscrit dans le prolongement de l’ambition que s’était initialement fixée le programme REGINE : susciter des recherches juridiques mobilisant le genre en France et les rendre visibles au plus grand nombre. Ce projet vise également à répondre à un manque éditorial autour de la publication des études de genre en droit qui, en particulier dans le monde francophone, peinent souvent à trouver leur place. Le titre Intersections entend souligner qu’il s’agit avant tout de travailler sur la confluence entre deux ordres normatifs – l’ordre juridique et l’ordre du genre. Il invite également à ne pas mobiliser le genre comme seul outil d’analyse, mais à croiser celui-ci avec d’autres grilles de lecture (classe, origine ou race, handicap, âge etc.), en somme, à penser le genre comme un concept globalement critique, ouvert à une approche intersectionnelle. Le projet est ouvert sur le plan disciplinaire : il s’agit d’accueillir aussi les écrits de non-juristes, spécialistes d’études de genre, qui travaillent sur l’objet « droit », et, de manière générale, de participer à rendre visibles auprès de la communauté des juristes, notamment à travers des recensions, les travaux de sciences humaines et sociales intéressant le droit et mobilisant le genre.
Si le projet colonial est assez volontiers associé à l’ordre racial — dès lors que la race, comme système socio-politique et juridique, a largement été inventée pour légitimer l’esclavage[1] ou le colonialisme[2] —, c’est plus tardivement qu’il a aussi été associé à un ordre genré. En 2008, la féministe argentine Maria Lugones a commencé à forger le concept de « colonialité du genre », posant l’hypothèse d’un « système moderne-colonial de genre », afin de mettre en avant l’idée selon laquelle le genre est aussi central que la race pour comprendre la colonialité[3]. De nombreux travaux antérieurs débroussaillaient déjà l’imbrication entre race, genre et pouvoir (du discours de Sojornour Truth en 1851 aux travaux de Angela Davis, bell hooks etc.).
En 2002, dans La chair de l’empire, l’historienne Ann Laura Stoler avait proposé, à partir d’une étude du régime colonial des Indes néerlandaises, une mise en évidence du caractère central à l’autorité impériale des inégalités de genre — centralité puissamment capturée par l’exergue du premier chapitre : « L’homme reste homme tant qu’il est sous le regard d’une femme de sa race »[4]. L’historien Todd Sheppard, spécialiste de l’empire colonial français, a lui aussi analysé le colonialisme au prisme du genre[5]. Les études postcoloniales font aujourd’hui une large place au genre[6]. Récemment, en 2023, un numéro de la revue Clio@Thémis coordonné par Loraine Chappuis, Hélène Duffuler-Vialle, Marie Houllemare, Florence Renucci et Todd Shepard intitulé Genre, histoire et droit, comprenait plusieurs études relatives au droit et à l’expérience coloniale[7].
Car le droit a, lui aussi, joué un rôle crucial dans le projet comme dans l’expérience et les régimes coloniaux ; pour le dire avec l’historienne Emmanuelle Saada : « la relation coloniale, loin d’être le fait d’une pure domination, a été dite dans les dispositifs du droit »[8]. Colonialité du genre, juridicité du projet colonial : Intersections. Revue semestrielle genre et droit invite donc, pour son troisième numéro thématique, à la soumission d’articles originaux s’attachant à analyser soit les effets de genre produits par le droit en contexte colonial, soit leur résonance dans le droit contemporain — que le droit soit ici appréhendé comme instrument de pouvoir ou de savoir. Les réponses au présent appel à contributions pourront prendre la forme d’études portant soit sur les régimes juridiques coloniaux (quels qu’ils soient, sans exclusive, notamment vis-à-vis de contextes analysés comme postcoloniaux), soit sur les sciences juridiques comme savoirs (post)coloniaux.
Pour ce qui est des régimes juridiques (post)coloniaux, les propositions pourront porter sur les différentes facettes de la consubstantialité du droit à l’entreprise coloniale et à l’ordre du genre qui y est associé. Elles pourront ainsi, par exemple, revenir sur la manière dont c’est en situation coloniale que nombre de catégories ou mécanismes juridiques encore aujourd’hui proéminents ont été forgés — comme, assurément, en droit de la nationalité et de la citoyenneté qui s’articulent largement autour de la catégorie juridique de l’« indigène »[9], mais aussi en droit administratif[10], en droit du travail[11], en droit de la famille[12], du point de vue du régime des cultes[13] ou de l’école etc.[14] — à condition que le travail proposé mette en avant la façon dont ces catégories s’appuient, renforcent ou modèlent un ordre genré. à la même condition de centralité du genre dans l’analyse, les contributions pourront se focaliser sur certain·es actrices et acteurs juridiques et institutionnels, disparus ou non, qui ont joué un rôle considérable tant dans le projet colonial que dans sa juridicisation[15] — en dépit de l’« oubli de l’empire » par la pensée juridique française. Une attention pourra également être portée non pas aux catégories et institutions, mais aux effets du droit en situation coloniale : on pourra s’intéresser à la violence[16] ou aux injustices, discriminations et inégalités de genre produites, aggravées et/ou légitimées par le droit.
Dans une perspective plus méta-analytique, les propositions pourront également s’intéresser davantage au droit comme savoir que comme pratique institutionnelle, administrative et normative — que ce soit dans une perspective historique ou épistémologique. Nous accueillerons ainsi des propositions visant à faire un retour analytique sur la mise en science du droit colonial[17] et postcolonial[18] — que ce soit au travers des nombreux Traités de législation coloniale qui accompagnèrent les régimes coloniaux[19], ou au travers de l’étude des savoirs constitutionnels[20], administratifs, notamment bureaucratiques, ou judiciaires[21] voire des discours politiques (notamment, articulés à l’idée républicaine[22]) qui en constituèrent la face empirique concrète — là encore, dès lors qu’ils seront analysés du point de vue du genre. Mais nous considérerons tout autant des contributions s’attachant à la réflexion épistémologique sur ce que le post-colonial fait aux catégories fondamentales de la pensée – et, notamment à la pensée juridique. En ce sens, une attention pourra être portée aux « épistémologies du Sud », tant dans le champ du droit international (autour et dans le sillage des TWAIL) que dans d’autres branches du droit.
Enfin, Intersections accueillera les propositions qui viseront à éclairer d’un jour nouveau par le prisme de la colonialité du genre les résonances contemporaines dans une multiplicité de branches du droit – droit de la nationalité et de la citoyenneté, droit de la famille, statut personnel, droit administratif, droit des institutions politiques et juridictionnelles, droit pénal, régulation du fait religieux, droit économique et du commerce international, droit international ou droit des étrangers et des migrations, droit de la sécurité publique et des régimes d’exception… Les normes de masculinité et de féminité qui s’y logent, de même que la contribution de ces branches du droit à la production d’une altérisation entre cultures arriérées sexistes et civilité du modèle occidental voire à l’instrumentalisation du féminisme au service de projets racialistes ou encore le rôle du droit au service du capitalisme racial qui sous-tend le projet colonial constituent autant de thèmes possibles.
Calendrier
Le dossier « la colonialité du genre : perspectives juridiques » est programmé pour publication dans le numéro 6 de la revue, en décembre 2026.
- Les propositions de contribution, sous la forme de résumés de 500 mots environ, doivent parvenir avant le 10 juin 2025. Elles doivent être déposées, en format .doc ou .odt via la plate-forme de la revue.
- Nous vous remercions par avance de rédiger votre proposition de manière anonyme, votre identité ne devant notamment pas transparaître des références bibliographiques ou de l’identification trop spécifique de votre terrain (ex. redonner la référence complète de vos propres travaux si vous souhaitez les citer et ne pas écrire « notre publication… »).
- Afin de faciliter notre procédure d’évaluation, merci, au stade de l’abstract, d’indiquer vos références bibliographiques dans le corps du texte (ex. Foucault, 1974) et non en notes de bas de page et d’accompagner votre proposition d’une bibliographie.
- Les propositions seront évaluées de façon anonyme par le comité de rédaction et une réponse vous sera apportée fin juin 2025 pour une date de remise des contributions début juin 2026. Les articles soumis feront l’objet d’une évaluation par les pair·e·s en double aveugle et pourront donner lieu à des demandes de modification avant leur éventuelle publication.
Intersections. Revue semestrielle genre et droit accepte les formats longs (pour les articles de dossiers, jusqu’à 75.000 signes). Nous vous remercions de bien vouloir respecter, lors de l’envoi des contributions finales, la charte éditoriale consultable sur : https://revue-intersections.parisnanterre.fr/index.php/accueil/about/submissions.
[1] Aurélia Michel, Un monde en nègre et blanc. Enquête historique sur l’ordre racial, Seuil, 2020, Coll. Points Histoire.
[2] Françoise Vergès, Le ventre des femmes : capitalisme, racialisation, féminisme, Albin Michel, 2017.
[3] Maria Lugones, « The Coloniality of Gender » [2008], in Wendy Harcourt dir., The Palgrave Handbook of Gender and Development. Critical Engagements in Feminist Theory and Practice, Palgrave Macmillan, 2016, p. 13. Ce faisant, Lugones prend appui sur la notion de colonialité du pouvoir développée par des auteurices comme pour désigner l’hégémonie et l’autorité universelles des discours et des savoirs occidentaux (voir : Aníbal Quijano, « Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en America Latina », in Santiago Castro-Gómez Santiago, Oscar Guardiola-Rivera Oscar, Carmen Millán de Benavides dir., Pensar (en) los intersticios : teoría y práctica de la crítica postcolonial, Bogota, Pontificia Universidad Javeriana (1999) ; Enrique Dussel, « Europe, Modernity, Eurocentrism », Nepantla: Views from the South, 2000, vol. 1, n° 3.
[4] Ann Laura Stoler, La chair de l’empire. Savoirs intimes et pouvoir raciaux en régime colonial [2002], La Découverte, 2013.
[5] Catherine Brun, Todd Shepard, Guerre d’Algérie : le sexe outragé, Payot, 2016 ; Todd Shepard, Mâle Décolonisation. L’homme arabe et la France, de l’indépendance algérienne à la révolution iranienne, Payot, 2017.
[6] V. par exemple le dossier coordonné par Eleni Varikas et Maria Eleonora Sanna, « Genre, modernité et colonialité du pouvoir », Cahiers du genre, 2011, vol. 1, n°50.
[7] V. le numéro de la revue : https://journals.openedition.org/cliothemis/3600
[8] E. Saada, « La République dans l’histoire coloniale », Cahiers Jean Jaurès, 2003/3, n°169-170, pp. 41-43 ; v. aussi, de la même auteure : « Penser le fait colonial à travers le droit en 1900 », Mil Neuf Cent. Revue d’histoire intellectuelle, 2009/1, n°27, pp. 103-116. V. encore, même auteure : « le droit a donné sens, orienté et informé en profondeur le rapport colonial », in « La loi, le droit et l’indigène », Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de cultures juridiques, 2006/1, n°43, p. 165-190.
[9] Emmanuelle Saada, « La loi, le droit et l’indigène », op. cit.. ; v. aussi : Olivier Le Cour Grandmaison, De l’indigénat, Anatomie d’un « monstre » juridique : le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français, La Découverte, 2010 ; Isabelle Merle, Lionel Zevounou, « Systématiser la différenciation raciale à travers le régime juridique de l’indigène : la contribution d’Henry Solus », Droit et société, 2021, n°3, pp. 593-605 ; Stéphanie Calvo, « La dimension raciale du droit de la nationalité ? », Plein droit, 2023/4 n° 139, p. 11-14.
[10] Gustave Peiser, « Droit administratif et colonisation », in Gilles Guglielmi, Histoire et service public, PUF, 2004, p. 217 ; Jean-François Boudet, « Les colonies et la construction du droit administratif français », in Geneviève Koubi dir., Droit et colonisation, op. cit., p. 279.
[11] Jean-Pierre Le Crom et Marc Boninchi dir., La Chicotte et le pécule. Les travailleurs à l’épreuve du droit colonial français (XIXè et XXè siècles), Presses Universitaires de Rennes, pp.125-146, 2021 ; v. aussi les actes de la conférence Le droit du travail dans les colonies, 2015 : https://idf.drieets.gouv.fr/sites/idf.drieets.gouv.fr/IMG/pdf/actes_de_la_conference-debat_2015.pdf
[12] V. par exemple les travaux de Judith Surkis, Sex, Law, and Sovereignty in French Algeria, 1830-1930, Cornell University Press, 2019 ; ou Emmanuelle Saada, « Paternité et citoyenneté en situation coloniale. Le débat sur les « reconnaissances frauduleuses » et la construction d’un droit impérial », Politix, 2004, vol. 17, n°66, pp. 107-136.
[13] V. par exemple les travaux de Raberh Achi, « La séparation des Églises et de l’État à l’épreuve de la situation coloniale. Les usages de la dérogation dans l’administration du culte musulman en Algérie (1905-1959) », Politix, 2004, vol. 17, n°66, pp. 81-106 et « La laïcité à l’épreuve de la situation coloniale. Usages politiques croisés du principe de séparation des Églises et de l’État en Algérie coloniale. Le cas de l’islam (1907-1954) », Histoire de la justice, 2005, pp. 163-176.
[14] Carole Reynaud Paligot, L’école aux colonies. Entre mission civilisatrice et racialisation, Champ Vallon, 2021.
[15] Bernard. Pacteau, « Colonisation et justice administrative », in Jean Massot, dir., Le Conseil d’État et l’évolution de l’outre mer français du xviie siècle à 1962, Dalloz, 2007, p. 49 qui cite sur ce point Emmanuel Laferrière : « les conseils du contentieux administratif des colonies ont eu, bien avant les conseils de préfecture de la métropole, un Code de procédure réglant avec précision, les formes des décisions, les recours dont elles sont susceptibles ».
[16] Isabelle Merle, « De la ‘légalisation’ de la violence en contexte colonial. Le régime de l’indigénat en question », Politix, 2004, vol. 17, n°66, pp. 137-162. V. aussi : Séverine Kodjo-Grandvaux, « Discours coloniaux et réception des droits africains : entre négation et re-construction », in Geneviève Koubi dir., Droit et colonisation, Bruylant, 2005, p. 53, p. 72 : « L’État colonial est un État du droit et non un État de droit », où « le droit [autorise]et [légitime]la violence coloniale ».
[17] Jean-Philippe Bras dir., Faire l’histoire du droit colonial, Karthala, 2015.
[18] Florence Renucci, « La “décolonisation doctrinale” ou la naissance du droit d’outre-mer (1946-début des années 1960) », Revue d’histoire des sciences humaines, 2011, pp. 61-76.
[19] V. aussi Florence Renucci, « Naissance et développement des grandes revues de droit colonial », in Frédéric Audren, Pierre-Nicolas Barenot et Nader Hakim dir., Les revues juridiques aux xixe-xxe siècles, à paraître.
[20] Olivier Beaud, « L’empire et l’empire colonial dans la doctrine publiciste française de la IIIème République », Jus Politicum, 2015 : http://juspoliticum.com/article/L-Empire-et-l-empire-colonial-dans-la-doctrine-publiciste-francaise-de-la-IIIe-8239-Republique-991.html
[21] Sylvie Thénault, Une drôle de justice. Les magistrats dans la guerre d’Algérie, La Découverte, 2004.
[22] Alice Conklin, A Mission To Cilivize. The Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895-1930, Stanford University Press, 1997 ; Carole Reynaud Paligot, La République raciale, une histoire 1860-1940, PUF, 2021, Coll. Quadrige ; Olivier Le Cour Grandmaison, La République impériale, Politique et racisme d’Etat, Fayard, 2009 ; Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, « Les origines républicaines de la fracture coloniale », in Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire dir., La fracture coloniale, La Découverte, 2005, p. 35. V. aussi Elsa Dorlin, La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française, La Découverte, 2009.